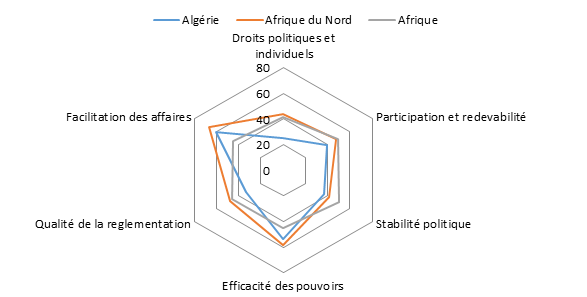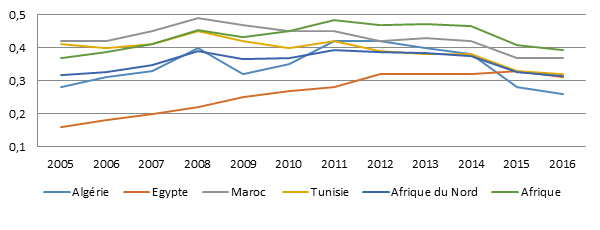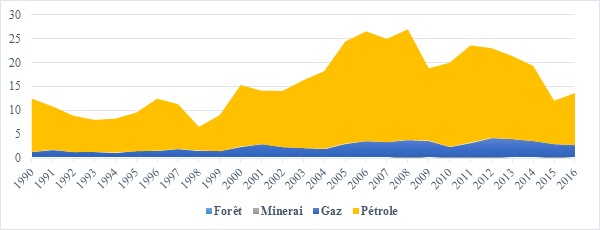Florian Léon et Ibrahima Dosso pour The Conversation.
De nombreux pays en développement sont vulnérables aux désastres climatiques et conflits, notamment en Afrique, en raison de leur plus forte exposition et/ou de leur plus faible capacité de gestion de ces chocs.
Afin de favoriser un développement pérenne, il convient de construire des systèmes économiques résilients. Dans cette optique, des recherches récentes ont cherché à évaluer les effets à long terme des conflits et/ou désastres naturels sur les économies et les moyens de les atténuer. Plusieurs travaux ont ainsi souligné que les désastres naturels et les conflits violents ont des effets à long terme sur les ménages, en particulier sur l’éducation et la santé des jeunes enfants.
Dans une étude récente, nous avons travaillé sur la capacité de résilience des entreprises ivoirienne à l’aune de la crise électorale de 2010-2011.
Les entreprises et la crise de électorale de 2010-2011
Les entreprises jouent un rôle essentiel dans la création d’emplois, de valeur ajoutée et la redistribution de la richesse dans l’économie ivoirienne.
Le tissu entrepreneurial des PME à lui seul emploie par exemple près de la moitié de la population active pour une contribution au PIB de l’ordre de 20 %.Mais, en dépit de leur importance pour l’activité économique, peu de travaux se sont intéressés à l’effet à moyen et long terme de ces adversités sur les entreprises.
Si l’activité économique est réduite suite à un choc, elle ne disparaît pas pour autant.
Les événements extrêmes tendent à stimuler le développement des activités informelles dans une logique de subsistance. En outre, les entreprises survivantes peuvent bénéficier d’effets positifs suite aux conflits en raison de l’entrée massive d’aides extérieures (financière, humaine et matérielle) ou de la disparition de concurrents. Enfin, les effets peuvent être différenciés selon les caractéristiques des entreprises et selon les secteurs d’activité.
Dans le cadre de notre étude, et contrairement aux travaux antérieurs, nous avons eu la possibilité de suivre l’activité de l’ensemble des entreprises formelles (locales et étrangères) sur une période longue : à compter de deux ans avant la crise et jusqu’à trois ans après.
La crise post-électorale ivoirienne a explosé à la suite des élections présidentielles qui étaient censées clore la décennie de crise politico-militaire qui avait conduit à une division du pays. De Noël 1999 aux accords de Ouagadougou en 2007, la Côte d’Ivoire a été secouée par un conflit interne. La crise de 2011 a lieu suite au second tour des élections présidentielles le 28 novembre 2010. Les deux candidats (le président sortant Laurent Gbagbo et son opposant Alassane Ouattara) clament la victoire. Des combats éclatent entre les partisans des deux camps de janvier à avril 2011.
En dépit de sa brièveté, cet épisode a eu de profondes conséquences. La Commission nationale d’enquête mise en place à l’époque comptabilise plus de 3 000 morts et plus de 700,000 déplacés.
L’activité économique a été fortement perturbée avec un embargo sur de nombreuses exportations, la fermeture de banques et un accès limité à certains biens (médicaments, carburants, etc.).
Après l’arrestation du président sortant (le 11 avril 2011), puis l’accession au pouvoir d’Alassane Ouattara, les combats se sont rapidement estompés et l’économie a pu repartir avec une croissance de plus de 5 % dans les années post-crise.
Les petites entreprises plus résilientes que les grandes
Pour comprendre comment les entreprises ont rebondi suite à ce choc, nous avons suivi les entreprises ivoiriennes sur plusieurs années.
Nos résultats montrent que trois ans après la crise, les entreprises n’ont récupéré que la moitié des pertes en termes de productivité. Cependant cette moyenne cache de fortes disparités individuelles.
Les plus petites entreprises (moins de 10 salariés) ont été en mesure de rebondir plus rapidement que les autres. Plusieurs explications peuvent être avancées. Tout d’abord, les petites structures sont plus flexibles pour faire face à un avenir incertain. Elles sont davantage tournées vers les marchés locaux, les rendant moins sensibles aux ruptures d’infrastructures, disposent d’une structure et d’une gestion beaucoup plus simples, ce qui leur permet de s’adapter plus immédiatement aux variations du marché et aux problèmes logistiques.
À l’opposé, les entreprises à capitaux étrangers tournées davantage sur l’extérieur, et donc ayant besoin d’un accès aux marchés étrangers (ports et routes), ont davantage souffert que les entreprises locales durant et après la crise.
Ces entreprises sont en effet vulnérables à une limitation d’accès aux marchés extérieurs à la fois pour les intrants et pour l’écoulement de leurs productions. De plus, elles ont été sans doute particulièrement impactées par l’exode des travailleurs étrangers.
Notre étude offre deux autres résultats intéressants en lien avec les recherches antérieures. Tout d’abord, les entreprises ayant recours à des travailleurs qualifiés et/ou ayant un niveau d’encadrement plus important, ont été particulièrement pénalisées.
Deux éléments complémentaires expliquent ce résultat. Tout d’abord, un certain nombre de travailleurs qualifiés ont fui la Côte d’Ivoire et ne sont sans doute jamais retournés par la suite. En effet, de nombreux travailleurs qualifiés sont des étrangers issus de pays voisins ou plus lointains (comme la France). Il est vraisemblable que cette nouvelle crise, qui est venue s’ajouter aux précédentes, ait induit une fuite permanente des plus qualifiés.
Ensuite, pour ceux qui sont retournés dans leur ancienne entreprise, il a fallu un temps d’adaptation. Une partie de leur compétence s’est érodée selon un processus de dépréciation des connaissances comme cela fut montré dans une étude antérieure sur le conflit en Sierra Leone.
L’accès au financement, un atout majeur
Notre recherche a aussi mis en évidence l’importance de l’accès au capital pour favoriser la reprise d’activité.
Les entreprises qui étaient les moins contraintes financièrement avant la crise de 2011 sont celles qui ont le plus facilement rebondi. Les banques mises en difficulté suite aux événements de 2011 ont sans doute privilégié leurs clients historiques (au détriment des autres entreprises). Nous observons notamment une augmentation des prêts en souffrance en 2011 pour les banques ivoiriennes, selon les données de la Commission bancaire de l’UEMOA, l’Union économique et monétaire ouest-africaine.
Ce résultat confirme les résultats d’une recherche sur les entreprises sri-lankaises suite au tsunami de décembre 2004. Cette étude a montré que l’aide financière a permis d’accélérer la reprise d’activité.
Ces nouveaux enseignements apportent ainsi un éclairage intéressant pour construire un système économique résilient. Si le recours aux travailleurs qualifiés et cadres est crucial pour favoriser le développement des entreprises, il peut constituer une source de vulnérabilité en cas de choc. Une entreprise trop dépendante de quelques travailleurs peut être fortement pénalisée en cas de disparition (mort, fuite) de ceux-ci.
Il convient de trouver des outils pour réduire cette vulnérabilité en développant d’une part, la formation des cadres et ingénieurs/techniciens afin d’accroître le vivier de capital humain disponible et en favorisant le retour et la remise à niveau de ceux-ci après un choc brutal (conflits, désastres naturels).
D’autre part, un accès rapide à des capitaux est crucial pour favoriser une reprise de l’activité. Des outils d’urgence, à l’image des prêts d’urgence du FMI, peuvent être développés pour favoriser l’octroi et le ciblage de crédits suite à un choc.
De plus, la réglementation bancaire peut aussi être adaptée aux situations extrêmes. Par exemple, un moratoire sur les ratios de capital pourrait être imaginé afin de permettre aux banques de continuer à financer l’activité réelle.
Enfin, il paraît essentiel d’étendre la réflexion aux acteurs non-bancaires (assurances, société de capital-investissement) et d’utiliser les avancées technologiques (mobile-banking, fintech) pour mobiliser et allouer les fonds efficacement et à moindre coût.