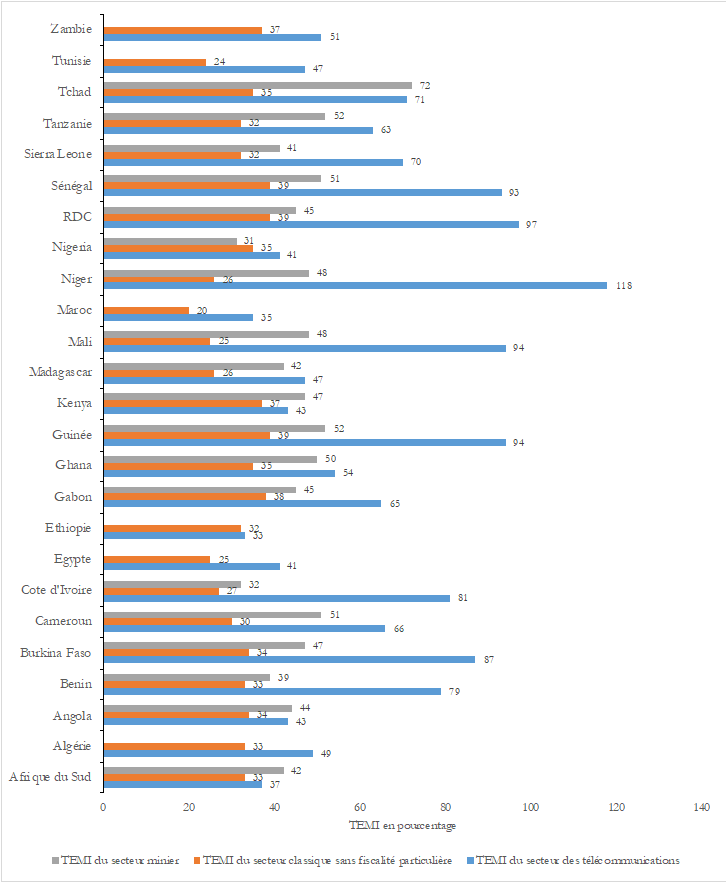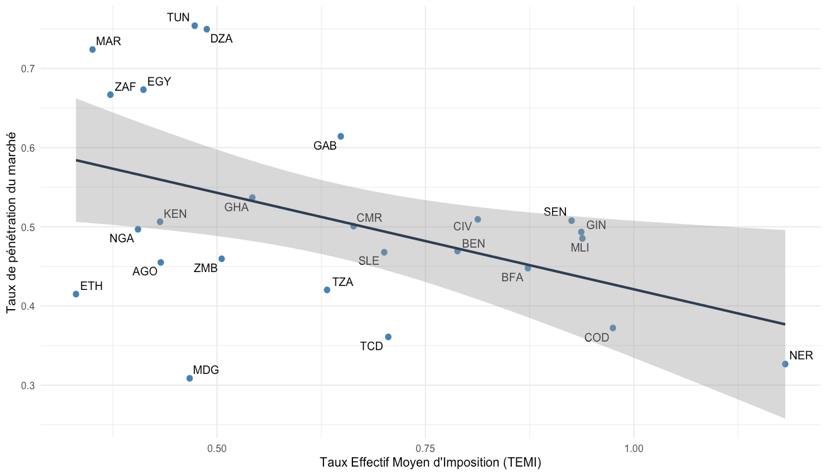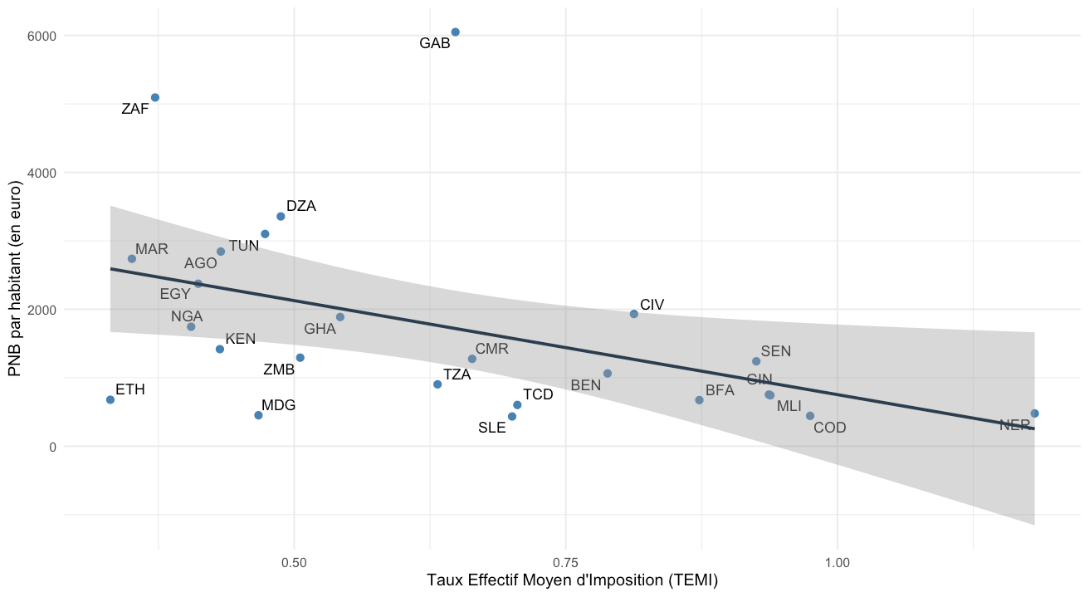L’avènement du numérique a révolutionné notre manière de vivre, de communiquer, d’apprendre et, bien sûr, de travailler. Cette transformation est d’autant plus significative en Afrique, où les jeunes font face…
L’avènement du numérique a révolutionné notre manière de vivre, de communiquer, d’apprendre et, bien sûr, de travailler. Cette transformation est d’autant plus significative en Afrique, où les jeunes font face à des défis uniques mais aussi à d’innombrables opportunités dans leur quête d’intégration au marché du travail.
Pour explorer ces dynamiques et les implications du numérique, nous avons rencontré des acteurs de l’écosystème éducatif africain en Côte d’Ivoire. Une série de témoignages qui attestent de l’importance grandissante que prend le numérique dans l’éducation, et de la nécessité d’accompagner ce mouvement.
” D’utile à nécessaire, de nécessaire à indispensable “
En seulement quelques années, et encore plus depuis l’avènement du Covid, le digital est passé d’utile à nécessaire, et de nécessaire à indispensable. L’intégration professionnelle, l’accès à l’information, les interactions, ou tout simplement l’adaptation aux exigences contemporaines font que l’adoption de la composante numérique dans la quasi-totalité des cursus de formation est devenue absolument essentielle. Le digital aujourd’hui permet aux jeunes de trouver une place dans ce monde en pleine mutation dans le sens où il facilite l’accès rapide à l’information et facilite l’apprentissage.
– Dia Jean-Fabrice – Chargé des études à l’Institut Ivoirien de Technologie[1]
” Former les formateurs ”
La détermination des jeunes du continent à prendre le virage du numérique est évidente. Encore faut-il trouver un moyen de mieux les équiper. Premièrement, les équipements et matériel numériques restent difficilement accessibles pour le plus grand nombre. Par ailleurs, il est essentiel d’investir dans la formation des formateurs, pour assurer une transmission adéquate des compétences numériques aux jeunes et favoriser leur intégration réussie dans un monde de plus en plus digitalisé. Enfin, il faut multiplier les opportunités où les jeunes pourraient mettre en application les compétences acquises à travers des stages en entreprises ou des alternances
– Jean-Delmas Ehui – CEO chez ICT4Dev [2]
” Une politique publique axée sur le numérique “
Outre les difficultés que représentent l’acquisition des matériels nécessaires et l’accessibilité des programmes de formation, l’une des barrières au développement numérique est le retard de mise en œuvre des politiques publiques en faveur du numérique, le manque de formation des formateurs, ainsi que l’absence de mesures incitatives pour les entreprises afin que ces dernières reçoivent les jeunes pour les stages pratiques.
Des changements sont nécessaires pour fournir un accès équitable aux ressources numériques et former les acteurs de l’éducation et de l’industrie : Financer l’achat de matériel et les infrastructures adéquates pour les établissements ; encourager des collaborations entre les établissements d’enseignement et les entreprises du secteur numérique pour faciliter les stages et les opportunités d’apprentissage pratique ; élaborer des politiques fiscales avantageuses pour les entreprises investissant dans la formation des jeunes et le développement de compétences numériques ;mettre en place des programmes de formation continue pour les enseignants et les professionnels afin de rester à jour avec les dernières avancées technologiques et pédagogiques.
– Jocelyne Mireille Desquith – Assistante du Coordonnateur Général du Programme Social du Gouvernement
” Partager ses idées et gagner en visibilité ”
Le digital révolutionne la gestion de carrière professionnelle en offrant un éventail d’outils et de ressources accessibles à tout moment et depuis n’importe quel lieu… pour peu que votre zone soit couverte par le réseau internet.
Au-delà de cet aspect, le digital offre aux jeunes une plateforme pour faire entendre leur voix et influencer le changement social. À travers les médias sociaux, les jeunes peuvent partager leurs opinions, leurs expériences et leurs revendications avec une audience mondiale, les aidant ainsi à élargir leur impact et à mobiliser un soutien pour leurs causes, ou faire écho aux idées qu’ils partagent.
– Achille Koukou – Directeur Général de Tg Master University [3]
La digitalisation offre un potentiel immense pour l’intégration des jeunes sur le marché du travail en Afrique. Cependant, des efforts concertés sont nécessaires pour surmonter les obstacles et exploiter pleinement ces opportunités, afin de créer un avenir prospère et inclusif pour tous les Africains. En mettant en œuvre ces mesures, l’Afrique peut réaliser son plein potentiel dans l’ère numérique, et offrir à sa jeunesse les outils nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution.
[1] L’institut Ivoirien de Technologies est un Institut bilingue français-anglais d’enseignement supérieur dédié aux technologies de l’information et de la communication, aux biotechnologies et à la gestion des affaires. En savoir plus
[2] ICT4Dev est une start-up spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions numériques et technologiques au service des acteurs du secteur agricole. En savoir plus
[3] Tg Master est une école préparant à un double diplôme Bachelor (Français et Ivoirien) en Digital Management et en Business Management. En savoir plus
 Omar Cissé :
Omar Cissé :